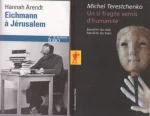Omniprésente dans les manuels scolaires, elle passe pour une grande philosophe, et on ne compte plus les livres, articles et documentaires qui chantent ses louanges. Phare de la pensée politique moderne, elle aurait tout compris : la démocratie et le totalitarisme, la cité antique et la société moderne, le mensonge et la violence, la Révolution et les droits de l’homme. Portée aux nues par la doxa universitaire, elle figure au panthéon philosophique de l’Occident démocratique. Elle passe pour une référence obligée, un point de passage incontournable destiné à tous ceux qui veulent comprendre le monde contemporain, ses contradictions et ses impasses.
Il n’y a qu’un problème : Hannah Arendt est elle-même une impasse théorique et politique. Il suffit d’ailleurs de la lire avec un peu d’attention pour s’apercevoir qu’elle a tout faux. Non seulement sa lecture de l’histoire moderne est erratique, mais sa vision de la démocratie est passéiste et réactionnaire.
Des preuves ? Elles sont légion. Ne pouvant tout examiner en une fois, on s’intéressera à la conception arendtienne de la démocratie. Dans Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt explique que la seule égalité légitime est celle qui règne entre les citoyens, et non entre les hommes. L’égalité dans la cité antique, à ses yeux, est sans commune mesure avec l’égalité qui prévaut dans les sociétés modernes. Tandis que la cité grecque est une remarquable aristocratie politique, la démocratie moderne est le théâtre d’un conformisme généralisé, où l’esprit de compétition s’est dilué dans l’égalitarisme et la médiocrité ambiante.
Cet éloge passéiste de la cité antique s’articule à une analyse particulière de l’agir humain. Si Arendt distingue le travail et l’action comme modalités de l’activité humaine, c’est pour dévaloriser le premier, qu’elle attribue à « l’homme-animal social ». Le travail est soumission à la nécessité naturelle, tandis que l’action, à l’autre extrémité, représente la noble dimension de l’activité politique. C’est pourquoi il faut parler d’un « animal laborans » pour désigner le travailleur, lequel « n’est jamais qu’une espèce, la plus haute si l’on veut, parmi les espèces animales qui peuplent la terre ».
La politique visant à l’émancipation des travailleurs, poursuit Arendt, n’a donc abouti qu’à « courber toute l’humanité, pour la première fois, sous le joug de la nécessité » Le travail productif n’étant que l’asservissement à la nécessité, « les hommes ne pouvaient se libérer qu’en dominant ceux qu’ils soumettaient à la nécessité ». Pour que les citoyens puissent s’adonner à l’exercice du pouvoir, il fallait que la production de leurs conditions d’existence fût assurée par une classe subalterne. Pour Arendt, cet état de fait est intangible, et vouloir transformer la condition des travailleurs n’a aucun sens. La sublimation du citoyen appelé à incarner les vertus nécessite, de tout temps, le travail manuel de l’animal laborans.
Cette idée-force, elle ne cessera de la marteler. Se demandant, dans son essai sur l’insurrection hongroise de 1956, s’il est possible de faire marcher des usines dont les ouvriers sont les propriétaires, la philosophe répond sans détour : « En réalité, il n’est pas sûr du tout que les principes politiques d’égalité et d’autonomie puissent s’appliquer à la sphère de la vie économique. Après tout, la théorie politique des Anciens n’avait peut-être pas tort lorsqu’elle affirmait que l’économie, liée aux nécessités de la vie, requérait pour fonctionner la domination des maîtres ».
La lutte contre la pauvreté ? Inutile d’y penser. Ignorant superbement la lutte des classes, Arendt estime que « la vie humaine s’est trouvée en proie à la pauvreté depuis des temps immémoriaux » et qu’« une révolution n’a jamais résolu la question sociale ni libéré des hommes du fléau du besoin ». Alors que les démocraties modernes, par leur obsession du social, ruinent les chances d’une véritable aristocratie des égaux, la cité antique avait compris que l’esclavage était le prix à payer pour l’exercice héroïque des vertus civiques. « Toute souveraineté tient sa source première, la plus légitime, du désir qu’a l’homme de s’émanciper de la nécessité vitale, et les hommes parvinrent à cette libération par la violence, en forçant d’autres à porter à leur place le fardeau de la vie ». Voilà qui est clair, et la conclusion s’impose : « Rien, pourrions-nous dire aujourd’hui, ne saurait être plus obsolète que d’essayer de libérer le genre humain de la pauvreté par des voies publiques ; rien ne saurait être plus futile ni plus dangereux ».
Mais ce n’est pas tout. Cette conception aristocratique de la vie politique conduit Hannah Arendt à nier l’universalité humaine, quitte à pulvériser un concept-clé hérité de la philosophie des Lumières : « La distinction entre l’homme et l’animal recoupe le genre humain lui-même : seuls les meilleurs, aristoi, qui constamment s’affirment les meilleurs et préfèrent l’immortelle renommée aux choses mortelles, sont réellement humains ». Reprenant explicitement la critique réactionnaire des droits de l’homme formulée par Edmund Burke, Arendt récuse l’universalité des droits humains. A ses yeux, c’est un principe funeste qui aurait pour effet de « réduire les nations civilisées au rang des sauvages », de ces populations primitives en qui elle voit « des gens sans-droits, qui apparaissent comme les premiers signes d’une possible régression par rapport à la civilisation ».
Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’Arendt voue une admiration sans bornes à la Révolution américaine, menée par des propriétaires d’esclaves, et qu’elle rejette la Révolution française, qui abolit l’esclavage colonial. De même que, dans les années 1960, elle refuse toute portée politique aux revendications des Afro-Américains pour les droits civiques et relègue au second plan ce qu’elle appelle dédaigneusement la « negro question ». Toute philosophie est sous-tendue par une certaine idée de l’homme et de la société. Celle que défend Hannah Arendt participe d’une idéologie réactionnaire qui justifie rétrospectivement l’esclavage et congédie le progrès social comme une dangereuse utopie. Ses détracteurs lui reprochent ses équivoques, l’indétermination de ses concepts, le mouvement erratique de sa pensée. Ce qui pose problème, c’est plutôt l’obscure clarté de ses anathèmes contre les idées progressistes et le compendium avarié de ses présupposés anti-humanistes. Exit Hannah Arendt.