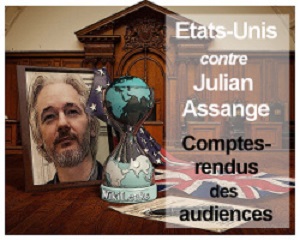Il n’y a pas si longtemps, une grande partie de la presse internationale ne tarissait pas d’éloges sur la Turquie, capable selon elle de produire de la richesse et d’assurer un développement comme peu d’autres pays avaient pu le faire ces dernières années. Hier encore, le modèle turc avait presque valeur d’exemple aux yeux des démocraties européennes touchées par la crise et engluées dans des processus décisionnels européens technocratiques. La Turquie n’a-t-elle pas connu un taux de croissance extrêmement favorable au point de devenir la seizième économie mondiale ?
Les manifestations de la place Taksim et la répression violente de la police ont depuis douché les plus optimistes. Les canons à eau, les gaz lacrymogènes, les blindés envoyés contre la foule rassemblée au parc Gezi et les coupures de réseau Internet ont soudainement éclipsé les bons résultats de l’économie. Les cinq mille blessés et le millier d’arrestations survenus lors des manifestations ont montré le vrai visage du président Erdogan à une opinion internationale jusque-là accaparée par les gratte-ciels qui ont poussé comme des champignons dans les riches quartiers d’Istanbul. Il est vrai qu’aux yeux de certains (la majorité ?), la Turquie avait accompli un petit miracle économique appuyé par des méthodes pour le moins musclées.
Si nous nous contentons d’une analyse superficielle qui englobe l’intégralité du pays en ignorant les Turcs dans leur individualité, M. Erdogan pourrait aisément passer pour un champion du capitalisme moderne. En suivant à la lettre les recommandations du Fonds monétaire international, le président turc a sorti son pays de la crise dans laquelle la Turquie était engluée jusqu’en 2001. En dix ans à peine, son PIB a triplé en valeur et ses exportations ont décuplé. Les infrastructures rivalisent quant à elles avec ce qu’on peut trouver sur la rive nord de la Méditerranée.
Le pays connaissait depuis dans une certaine euphorie. Aux environs de 2040, d’après les prévisionnistes de Goldman Sachs, Ankara ne devait-elle pas dépasser Paris en termes de PIB et se hisser au neuvième rang mondial ? Nageant à contre-courant, de rares observateurs avaient cependant fait remarquer que le fossé ne cessait de se creuser entre les classes sociales les plus aisées et les autres. Dans le barème établi périodiquement par l’OCDE pour mesurer l’inégalité des revenus au sein de ses 34 membres, la Turquie occupe ainsi sans surprise une peu glorieuse troisième place. L’institut turc de la statistique tirait d’ailleurs la sonnette d’alarme quelques mois en arrière : la moitié de la population percevait un salaire inférieur à 230 $ mensuels (données 2008). Quant aux 20 % des ménages les plus riches, ils gagnent huit fois plus (25.894 $ par an) que les 20 % les plus pauvres (3.179 $). Pis, 16 % de la population vivaient en 2011 sous le seuil de pauvreté. Allez parler à ces gens-là de parler de miracle économique…
Mais ce n’est pourtant pas tout. La Turquie occupe un pitoyable 90ème rang dans l’indice de développement humain développé par les Nations-Unies. Rien d’étonnant quand son sait que c’est l’un des pays où les enfants qui travaillent ont le plus gros volume horaire, soit 51 heures par semaine (la Turquie n’occupe que le 132ème rang mondial en matière d’alphabétisation). La seizième économie du monde n’est manifestement pas prête à tenir tête en matière de qualité de vie à des pays comme la Roumanie, l’Albanie, le Costa Rica, le Liban ou Palau.
Ce n’est pas tout. Obéissant à des objectifs à courte vue, la Turquie n’a quasiment pas porté attention à la qualité de son aménagement urbain. Istanbul, littéralement envahie par les hôtels de luxe, des gratte-ciels déprimants et des dizaines de centres commerciaux, en est un bien triste exemple. La capitale turque est devenue la ville européenne avec le plus faible pourcentage d’espace vert. Le dernier espace bucolique du centre-ville était justement le parc Gezi, un des rares lieux de détente et de sociabilisation entre les habitants. Ces derniers ont tenté de le défendre face à la fureur destructrice des bulldozers. Les arbres doivent disparaître pour laisser la place à la reconstruction d’une ancienne caserne qui avait été démolie en 1940. Depuis quelques jours, les manifestations représentent la cristallisation d’un certain ressentiment social, d’une frustration, face à un gouvernement qui utilise des méthodes de plus en plus autoritaires, voire liberticides. Les raisons de se révolter ne manquent pas. Les gens n’ont plus peur.
Capitaine Martin
http://www.resistance-politique.fr/article-le-soi-disant-miracle-econo...