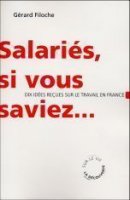L’autre jour, à un souper d’amis, on me disait qu’il était normal et juste qu’un entrepreneur gagne plus qu’un simple employé. Sur le moment, je dois l’avouer, je ne sus répondre tellement la sentence avait l’air logique et correcte. Cependant, il y a quelque chose qui sonnait faux et qui allait engager chez moi, dès mon retour, une réflexion. Une réflexion d’autant plus importante qu’elle avait trait à une des justifications centrales de la politique des inégalités.
C’est vrai, il est normal et juste qu’une personne qui travaille plus pour la collectivité perçoive une reconnaissance qui soit au niveau de l’effort qu’elle a fourni. Le fait est que les formes de reconnaissance à l’intérieur de notre environnement socioéconomique actuel sont réduites le plus souvent à l’argent. En fait, on peut dire que le monopole de l’argent et des échanges monnayés sur les autres formes de reconnaissance – comme, par exemple, le remerciement, le regard empli de gratitude ou l’échange de service – a pris une importance considérable dans les relations humaines et sociales. Or, que l’argent soit le moyen générique qui a été choisi par l’humain pour ses échanges n’est pas un problème en soi. En revanche, cela serait une erreur de ne voir en l’argent qu’un moyen ou même une finalité, car il est surtout, en dernière analyse, un pouvoir. Un pouvoir de faire travailler l’autre pour moi. Dès lors, on comprend que le « gagner plus » n’est pas neutre socialement. Il fait référence à une certaine hiérarchie économique où il y a des dominants et des dominés quand bien même nous ne pouvons plus les identifier en tant que classe sociale. Alors que le pouvoir de l’argent bouge sans cesse faisant croire à une démocratie, le pouvoir des positions et l’idéologie des possédants au-dessus des moins-possédants restent identiques à eux-mêmes. Il faut absolument maintenir le consommateur dans la croyance en sa souveraineté pour effacer sa position d’employé subalterne, pour effacer sa domestication économique.
Par conséquent, le reproche que j’avais envie de faire à cette personne c’est que nul n’a demandé à l’entrepreneur ou à quiconque de travailler plus ! Certes, il en a le droit en tant que sujet libre, mais il ne peut pas, sur une motivation qui est tout de même la sienne, exiger de l’autre une reconnaissance qui, comme je l’ai expliqué, dépossèdera celui-ci d’un pouvoir qui devrait être partagé et collectif ; d’un pouvoir qui, s’il n’existait pas, pourrait être l’« organisation mutuelle des citoyens polyvalents et responsables ».
À ce stade de la réflexion, il n’est peut-être pas inutile d’inviter le lecteur à songer à ce qui est nécessaire pour l’homme à sa survie. C’est vrai : pourquoi devrions-nous travailler plus, alors que tout semble indiquer – que cela soit écologiquement (les ressources), socialement (le chômage) ou même subjectivement (le sens) – qu’il serait préférable, au contraire, que l’on travaille moins et que l’on dédie, par conséquent, plus de temps à l’organisation mutuelle ? De plus, avons-nous véritablement besoin de toutes ces choses ? N’y a-t-il pas dans cette frénésie de l’entrepreneuriat l’arrogance à peine déguisée de celui qui veut profiter des autres tout en les méprisant par le pouvoir qu’il s’autorise sur eux ? Ne faudrait-il pas que cela soit justement l’entrepreneur – qui n’a encore rien, mais qui va vers le « tout » – qui dirige son travail sur le sens profond de son engagement envers les autres et envers lui-même ?
Quant au « gagner plus », il fait sens, mais seulement à l’intérieur de notre propre enfermement économique et spirituel. De la même manière, je me demande : pourquoi faudrait-il que l’employé gagne moins, alors qu’il participe également à l’effort collectif ? Certes, l’entrepreneur, ou celui qui est devenu riche pourra toujours se défendre en évoquant son sacrifice passé et sa responsabilité présente. Mais a-t-il pris la peine de s’arrêter un moment dans son effort pour s’interroger sur le pourquoi de cette course ? Je ne suis pas en train de dire que son sacrifice ne sert à rien ; au contraire, je crois qu’il sert mais pas au bon endroit. Quant à la question de la responsabilité, cela pourrait véritablement être le thème d’un prochain article.
Finalement, une dernière question reste en suspend et c’est peut-être la plus importante : dans un monde qui promet chaque jour la pauvreté et l’exclusion, l’individu a-t-il vraiment la possibilité de ne pas se soumettre à la règle de la concurrence et de la marchandise ?
Luca V. B.
Doctorant en philosophie politique et sciences sociales