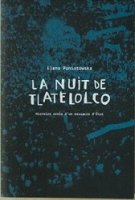Ce texte a été rédigé dans le cadre d’une participation à un débat organisé par « l’association qui ne manque pas d’airr ». Un mouvement constitué contre un projet d’implantation d’éoliennes industrielles au dessus du petit village de Vaour, dans le département du Tarn. Le projet avait été conçu, et virtuellement imposé, à une population que l’on n’avait absolument pas consultée. Les réactions de ladite population, la chance ou le bon Dieu Eole, ont fait que les énormes machines, apparemment, sont allées tourner sous d’autres cieux, peut-être moins regardants.
1/Le système des cargos dans la tradition indigène et le mouvement zapatiste
En janvier 1994, les indigènes zapatistes, mayas et zoques du Chiapas, se sont soulevés, les armes à la main, face à un système qui les privait de tout depuis 5 siècles : terre, nourriture, logements décents, santé, travail, éducation... Depuis, ils ont posé leurs armes, mais entrepris de construire une société autonome et originale dans ce coin perdu et superbe du sud-est mexicain.
Ces gens, que l’on appelle « indiens », se reconnaissent, eux, comme « indigènes ». Ils se distinguent du reste de la population (du Mexique, par exemple), par le fait qu’ils vivent dans des communautés (villages) sur un même territoire. La propriété privée de la terre n’existe pas chez eux (c’est une aberration, la terre-mère est sacrée... on dit souvent, et eux-mêmes le disent, mais pas pour la galerie, que c’est nous qui appartenons à la terre). Le territoire fait l’objet d’une gestion collective, dans le cadre d’une organisation horizontale, démocratique, très précise, qui s’appuie également sur des tâches effectuées collectivement de manière régulière. La conservation de leurs langues (au Chiapas on parle encore une dizaine de langues mayas, plus le zoque), le fait de partager une vision du monde et des traditions culturelles communes, sont, enfin, les autres éléments essentiels qui caractérisent ces populations indigènes.
D’emblée, ce mouvement étonne et force l’admiration, à cause de plusieurs caractéristiques :
En premier lieu, on est saisi par la force des zapatistes, par la fermeté de leur résistance. Ceci, alors que leur situation pourrait sembler extrêmement précaire.
Dans les régions des Altos (les Hautes Terres), l’absence de place pour cultiver et vivre est flagrante. Habitations, champs de maïs, troupeaux de moutons et êtres humains se partagent des territoires manifestement trop petits, d’autant plus qu’une bonne partie de cette région, entre 1500 et 2800 mètres d’altitude, est abrupte... vraiment pas le lieu idéal pour faire passer une charrue.
Dans la forêt Lacandone et les vallées qui la traversent, la prolifération des installations militaires et celle des groupes paramilitaires, ainsi que la construction de routes et autoroutes, les projets touristiques (rebaptisés écotouristiques, le pouvoir n’ayant jamais peur des mots !), l’implantation de cultures industrielles, toute cette avancée du monde capitaliste moderne, dans lequel des groupes humains autonomes, non soumis au salariat ou aux lois du marché, n’ont évidemment plus leur place, tout cela semble absolument imparable.
Pourtant, malgré la terrible pression économique et militaire de la « guerre de basse intensité » que lui livrent les gouvernements locaux (notamment celui de l’état du Chiapas, dirigé par le PRD, membre de l’Internationale Socialiste) et celui de la république fédérale, les zapatistes construisent une véritable « autonomie ».
Ayant coupé tout lien d’inféodation avec ceux qu’ils désignent sous le terme de « mauvais gouvernements », les zapatistes ont instauré, dans les cinq espèces de « capitales régionales » appelées « caracoles » (escargots), cinq structures d’ auto-gouvernement, les « Conseils de Bon Gouvernement » (ou encore : Juntas de Buen Gobierno).
Ils ont mis en place leur propre système de santé : des cliniques et micro-cliniques, des dispensaires et des équipes de promoteurs de santé se rendent de communauté en communauté, aussi bien pour assurer des soins que pour renforcer la prévention, mais aussi pour recueillir les connaissances des plus âgés, notamment des femmes, en matière de plantes médicinales, de suivi des grossesses, d’accouchements, etc.
Ils possèdent leur système scolaire : des écoles secondaires où se forment les promoteurs d’éducation. Ces jeunes gens et jeunes filles retournent ensuite dans leur communauté pour définir, en liaison avec les adultes et autres autorités locales, les programmes de ce qu’ils vont enseigner aux enfants dans l’école du village.
La police et la justice sont elles aussi directement assurées au niveau des quelques 1400 communautés, des municipes autonomes (il y en a 38) et des Juntas de Buen Gobierno, dans les 5 caracoles.
Enfin, au plan économique, le travail collectif pour la production alimentaire (champs de maïs, de haricots, rizières ou potagers, bétail ), permettant une fois nourries les familles de répartir ou commercialiser les excédents, assure une redistribution, notamment en direction des plus âgés et des malades, ainsi qu’ en soutien de l’effort de celles et ceux qui travaillent dans la santé, l’éducation, etc.
Cette organisation est à vrai dire assez impressionnante : malgré l’évidente pauvreté, les tensions et la violence liées à la militarisation et la paramilitarisation de la région, malgré aussi le travail parfois rude (en premier lieu pour les femmes), on peut voir que les populations zapatistes sont en mouvement, actives, solidaires, et que leurs constructions vont de l’avant. La tranquillité, la joie de vivre et d’être ensemble ne sont pas pour la photo. Tout cela se respire et se sent, pour qui séjourne quelque temps parmi eux.
Les zapatistes n’ont pas inventé cette organisation communautaire. Le système découle d’une tradition ancienne, très probablement bien antérieure à l’arrivée des Espagnols au début du XVIème siècle, et qui a subsisté en dépit, et contre la dure oppression qu’ils ont dû subir (s’il fallait donner un chiffre, rappelons que plus de 90% des Amérindiens ont été anéantis en 150 ans de domination européenne).
Cette organisation ancienne s’appuie sur ce que l’on appelle en espagnol les « cargos », les charges. Il s’agit de responsabilités à caractère rotatif et révocable, non rémunérées, attribuées dès l’adolescence aux membres de la communauté. Ceci pour une durée d’un an, avec des périodes de « repos » entre deux exercices de ces « charges ».
Les charges concernent un éventail très large de tâches et d’activités, qui vont généralement du plus simple au plus complexe, par exemple de l’entretien d’un lieu de culte, d’un chemin ou des abords d’une source, à la préparation des fêtes religieuses et à l’exercice de la justice, en passant par la police et différentes fonctions « administratives »...
L’individu qui s’acquitte correctement des différents échelons de ces tâches fera partie, avec les années, des « anciens », des « autorités » de la communauté.
Le système colonial a bien évidemment influé, depuis 500 ans, sur l’exercice de ces « charges ». La dénomination même des cargos, leur hiérarchisation et le contrôle des responsables par l’administration et les autorités religieuses ont permis aux Espagnols, et plus tard à l’état indépendant du Mexique d’affiner et de renforcer leur domination sur les indiens. Ces responsabilités varient d’une région à l’autre, avec l’inclusion ou non des femmes (dans l’immense majorité des cas, écartées des responsabilités « extérieures » dans les systèmes sociaux hiérarchisés). Mais si le pouvoir a tenté de contrôler les communautés, à travers les caciques, quelque soit la forme employée pour leur nomination, il n’est jamais parvenu à faire disparaître le principe de ce gouvernement par en bas, au niveau du village, en dehors (et souvent contre elles) des autorités d’un état sur lequel elles n’ont aucune prise.
Les zapatistes de l’EZLN n’ont donc fait que reprendre et perfectionner l’organisation de ces cargos, en y réintroduisant la participation des femmes, et en les débarrassant, évidemment, de la manipulation de l’administration et des « mauvais gouvernements ».
Les cargos permettent la mise en marche et le fonctionnement de l’autonomie. Notons que les tâches des promoteurs de santé, d’éducation et de communication (les hommes et femmes qui participent à la circulation de l’information, à la fabrication de documentaires, etc), entrent dans ce cadre des charges.
La non rémunération, compensée par les coups de main donnés pour les travaux agricoles, ou une aide en nature rendue possible grâce au travail collectif, est toujours une des caractéristiques essentielles du système des charges. En même temps, rappelons-le, que la révocabilité, la rotation, etc., La désignation des responsabilités se fait par consensus, dans le cadre des assemblées de la communauté.
Etre désigné pour l’une d’elles est un honneur, une reconnaissance, et l’individu se doit bien sûr de se montrer à la hauteur de la mission qui lui est confiée.
La communauté se dote ainsi des moyens de transmettre et d’utiliser au mieux les compétences de ses membres dans les différents domaines, en adéquation avec ses besoins, coutumes et intérêts, à la recherche d’une harmonie réelle entre ses habitants, mais aussi avec les communautés voisines.
Les zapatistes ont étendu le système des charges communautaires au fonctionnement de leur autogouvernement, c’est à dire à la désignation des personnes qui vont siéger, pour une période déterminée, dans les « municipes autonomes », regroupant chacun des dizaines de communautés, et aux « Conseils de Bon Gouvernement » nommés dans les 5 régions géographiques du Chiapas indigène rebelle.
Dans ce dernier cas, celui des Conseils de Bon Gouvernement (Juntas de Buen Gobierno), les hommes et les femmes désignées pour gouverner leur région ont un « mandat » qui court sur 3 ans. Mais ils ne siègent que par rotation, pendant des périodes de 10 jours. Une fois terminées ces périodes, chacun repart dans sa communauté, vaquer aux occupations « ordinaires », c’est à dire, principalement, à la vie du village et à l’entretien du champ de maïs (les parcelles de culture sont individuelles, ou collectives selon les régions).
Cette organisation permet à un maximum de personnes d’apprendre l’auto-gouvernement. Les zapatistes reconnaissent qu’ils perdent indubitablement en efficacité, en suivi des dossiers, etc., mais ils insistent sur l’énorme avantage de ce partage réel, par en bas, des responsabilités les plus importantes.
Une dernière remarque : les zapatistes tsotsil d’Oventik appellent leur « Conseil de Bon Gouvernement » Snail tzobombail yu’un lekil J’amteletik , ce qui veut dire, à peu près, « la maison de réunion pour ceux qui travaillent au bien commun »...
Les mayas ont bien fait quelques emprunts à la langue espagnole, pour nommer des objets ou des animaux qu’ils ne connaissaient pas avant l’arrivée des envahisseurs : vakax, par exemple, pour désigner une vache, ou mexa, pour la table, mesa en espagnol. Mais ils n’ont jamais adopté des mots concernant des concepts leur paraissant trompeurs : le mot « démocratie », entre autres, n’est pas dans leur dictionnaire. La défense des langues vernaculaires sert aussi à cela, ne pas se laisser manipuler.
2/ L’assemblée de la communauté indigène zapatiste : son rôle et son fonctionnement
Lors des « 2èmes Rencontres avec les peuples du mondes », organisées par les communautés zapatistes du Chiapas au cours de l’été 2007, celles-ci ont apporté des explications claires sur leur organisation, et le fonctionnement de leurs assemblées.
Etant collectivement propriétaires (il vaudrait mieux dire « responsables ») du territoire de leur communauté, ses membres sont placés dans une situation « objective » d’égalité et de co-gestion.
Par ailleurs, de nombreux éléments de leur culture, de leur cosmovision, que l’on retrouve y compris dans la structure de leurs langues, de multiples traditions viennent conforter ce refus de la hiérarchie, cette affirmation d’une égalité de condition et de droits entre les individus. On peut citer à ce propos, parmi bien d’autres exemples relevés par des historiens, la coutume consistant à confier à une personne qui s’était enrichie dans le cadre de son activité (commerce, etc.) la charge de mayordomo, c’est à dire de responsable de l’organisation des fêtes religieuses dans la communauté. Cette charge représentait à la fois un honneur et une reconnaissance. Mais elle impliquait également beaucoup de frais, pour la personne ainsi honorée, qui devait payer de sa poche les dépenses liées aux multiples fêtes (feux d’artifice, boissons, nourriture, etc.), et
se retrouvait complètement « à sec » à la fin de l’exercice de sa charge... Une façon élégante d’empêcher que les disparités sociales s’installent dans le village, n’est-ce pas ?
L’assemblée communautaire a pour objet l’organisation de la gestion collective de ce qui appartient au village : des biens fonciers, c’est à dire les terres, ainsi que les bois, les cours d’eau et les sources, les ressources qui s’y trouvent. Mais également les biens immatériels, à savoir la vie culturelle, religieuse et festive, les rapports sociaux, la transmission des connaissances, la santé, la sécurité, etc.
Les terres, dans les zones rebelles zapatistes, sont parfois divisées en parcelles attribuées à chaque famille, transmissibles de père en fils ( chez les zapatistes une fille peut hériter d’une parcelle, mais ce n’est pas encore généralisé). Ces parcelles sont bien évidemment inaliénables, c’est à dire que l’on ne peut les vendre ou les acheter, les soustraire au territoire de la comunidad. On a donc affaire à un droit d’usage, et non au
droit de propriété.
Les parcelles agricoles (les champs de maïs, de haricots, de riz ou d’autres cultures) peuvent également être cultivées collectivement, et les fruits des récoltes sont partagés au sein de la communauté. C’est le cas, généralement, dans les terres récupérées après le soulèvement de 1994.
La gestion des terres et des ressources, à laquelle il faut ajouter l’organisation du travail collectif (qui est la norme, même dans les zones où les parcelles sont individuelles), plus les questions sociales, politiques et culturelles, font donc l’objet de décisions communes, prises en assemblée pour les plus importantes.
La composition et le déroulement de l’assemblée :
Tous les membres de la communauté peuvent (et doivent, sauf raison particulière) y participer. Hommes, femmes, enfants (tant qu’ils ne s’endorment pas...)
Tout le monde a le droit à la parole. Le principe de l’égalité entre les individus est très fort, comme il est dit plus haut. L’idée que personne ne vaut plus qu’un autre semble l’évidence la plus élémentaire.
En général, c’est une « autorité », ou bien un membre de la communauté ayant un problème particulier à poser, qui présente le débat.
Ensuite, vient un moment où tout le monde, quasiment, parle. On peut avoir l’impression d’une confusion.
Puis c’est de nouveau un ancien, une autorité, qui prend la parole pour tenter d’exprimer l’avis général : « la communauté pense que... »
Il peut être approuvé, ou contesté dans sa synthèse. Dans le premier cas, un « accord », verbal, est pris. Cette décision fera office de loi jusqu’à la prochaine assemblée. Pas besoin de procès-verbal, de papier, d’huissier ou de caméra vidéo. La parole est sacrée.
Dans le deuxième cas, s’il y a contestation, la discussion reprend de plus belle. Si on arrive à un consensus, la décision est prise.
Dans le cas contraire, on ne prend pas de décision, on la remet à plus tard. Il n’y a pas de vote, pour passer en force, ni à 50,01%, ni à 75%... La cohésion de la communauté demande le consensus, l’unanimité, et refuse la division, y compris celle qu’engendrerait l’imposition d’une décision de la majorité sur une minorité.
Les décisions concernent quasiment tout : désignation des charges de responsabilités (les cargos dont on a parlé), organisation du travail collectif, questions de solidarité, d’éducation, plus les différents et conflits éventuels, qu’il est important de régler, et bien sûr tout ce qui concerne l’implication de la communauté dans la résistance et la construction de l’autonomie. Ceci au niveau local, à celui des « municipios » (municipalités) autonomes, et des Conseils de Bon Gouvernement.
La recherche de l’harmonie est une constante, à la fois au sein de la communauté et à l’échelon des relations de voisinage : le compromis est souhaité pour tout conflit interne ou externe (territoire, contestation, comportements vus comme répréhensibles ou nuisibles : par exemple coupe de bois vert, coupe de bois près d’une source, vol éventuel...).
Tout le monde connaît tout le monde, dans des communautés assez réduites (quelques centaines d’habitants au maximum). On ne parle donc pas pour s’assurer une position dominante, ou pour épater la galerie.
Répétons-le, la vision dominante est celle de l’intérêt commun, bien réel, et qu’il faut préserver et renforcer.
Dans un système où les moyens de production (les terres) ne sont pas privés, et où les responsabilités sont rotatives et peuvent faire l’objet d’une révocation, ce mode de fonctionnement paraît naturel et logique.
L’assemblée peut durer longtemps. Les gens sont rompus à ce genre d’exercice, car ils passent énormément de temps à parler ensemble.
La participation des femmes, et d’autres facteurs non négligeables, comme l’absence de consommation d’alcool, sont des éléments qui viennent renforcer l’efficacité des assemblées. De plus, la gaieté cohabite avec le sérieux, dans ce genre de réunions.
Dans les communautés zapatistes, les activités liées à la résistance et la construction de l’autonomie, les conflits multiples avec les autorités officielles (l’occupation militaire, avec 60 000 soldats pour une population civile rebelle de quelques centaines de milliers de personnes , et la pression policière, qui multiplie les provocations), qu’elles soient locales, régionales (l’état du Chiapas, dirigé par le gouverneur « de gauche » Juan Sabines) ou nationales (au niveau de l’état fédéral, dirigé par l’extrême droite Felipe Calderón), ou encore avec les villages non-zapatistes (priistes, perredistes, voire paramilitaires, car le conflit autour des terres est aigu, le gouvernement proposant de redistribuer les terres occupées après 1994, en parcelles privées), tout cela rend ces palabres, débats et assemblées plus qu’indispensables.
Quelques conclusions :
Le résultat de ces pratiques des indigènes zapatistes, c’est la force de la pensée collective, des questions réfléchies ensemble, et des décisions appliquées une fois prises.
Il est difficile de s’expliquer autrement la résistance que sont capables d’opposer les communautés et les organisations en rébellion à la guerre de basse intensité que leur livre le pouvoir depuis 15 ans.
Cet auto-gouvernement, certainement loin d’être parfait, représente à la fois la récupération d’une tradition (que d’autres communautés ont abandonnée ou dévoyée, sous la pression notamment des manoeuvres de division opérées par les différents pouvoirs, externes et internes, des illusions engendrées par un progrès qui n’en est pas un, de la soumission à l’état providence, qui n’a pourtant jamais raté une occasion pour les mettre au pas) et un énorme effort d’imagination et de construction. Pour refaire l’autonomie dont les indigènes ont besoin, s’ils veulent continuer à être ce qu’ils sont, à mener la vie qu’ils considèrent comme seule souhaitable, sur ce qu’ils ont de plus cher : leurs terres communes.
On pourrait ajouter que la démocratie (le pouvoir du peuple) ne peut exister que si une population l’exerce réellement et directement. Pour cela il lui faut partir d’en bas, et non déléguer, s’appuyer sur sa culture, sur une égalité concrète entre les individus, sur la gestion collective et solidaire des biens les plus précieux (la terre, l’air, l’eau, les plantes, la nourriture, la mémoire, la solidarité, la danse, la musique, etc), ceux qui rendent la vie possible et belle. C’est une des leçons que l’on peut tirer de l’expérience zapatiste.
Jean-Pierre Petit-Gras
pintemps 2009