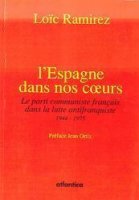La route est en bon état. En très bon état même. Elle nous conduit de Minsk, la capitale, jusqu’au Sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Ukraine. Je n’ai pas tout de suite réalisé qu’il n’y avait pas de péage. Ni sur celle-ci, ni sur aucune route du territoire d’ailleurs. Elles sont toutes publiques. Nous traversons plusieurs villages jusqu’à atteindre celui d’Axova (Ахова), à moins d’une heure de route de la grande ville de Pinsk. Combien d’habitants habitent ce hameau ? A en croire le nombre de datchas, peut-être une cinquantaine. A l’entrée de la bourgade, on distingue une école derrière une clôture et des arbres. Sur le sol, un dos d’âne incite les automobilistes à freiner et une peinture sur le bitume informe de la présence fréquente d’enfants au passage piéton suivant. En cette matinée de septembre, c’est jour de rentrée pour les écoliers. Chemises blanches et robes sont à l’honneur. Accompagnés par leurs parents, une trentaine d’enfants se regroupent devant l’entrée du bâtiment scolaire où les attendent leur directrice et un fonctionnaire du ministère des Situations d’urgence (l’équivalent d’un pompier). « Voici les nouveaux manuels scolaires que nous allons vous distribuer pour entamer cette nouvelle année au sein de notre République du Bélarus » explique Galina, la directrice. Après le discours, l’hymne national retentit pendant que quelques parents réprimandent du regard les élèves les plus agités. Le fonctionnaire du ministère, vêtu d’un uniforme vert, détaille brièvement les consignes de sécurité du piéton et les dangers liés à la route avant de distribuer des petits livrets sur le sujet. Une fois à l’intérieur de l’école, Galina témoigne de sa satisfaction de pouvoir profiter de locaux malgré un faible nombre d’élèves. « Beaucoup de familles quittent les villages pour aller dans les grandes villes » dit-elle avec regret, « mais grâce à notre gouvernement, et notre Président, nous disposons d’une école digne de ce nom ». Bien que modeste, l’école affiche, en effet, une allure respectable : gymnase, salle de représentation, hall décoré pour la rentrée, les salles de cours propres, tout est prêt pour accueillir les enfants.

Loin d’être une exception, le cas d’Axova est révélateur du rôle de l’Etat au Bélarus (souvent traduit sous le terme de Biélorussie). Celui-ci s’assure une présence dans les territoires les plus reculés de ce petit pays de 207 600 km2, ancienne république de l’URSS, coincé entre la Russie à l’Est et la Pologne à l’Ouest. Pour celui qui a voyagé dans d’autres pays du continent (ou même du monde) il ne sera pas difficile d’être frappé par la constance qui règne au Bélarus au niveau du bon fonctionnement des infrastructures, de l’entretien des villes et des parcs ou tout simplement de l’accessibilité à certains services publics. Quelque soit la ville (Gomel, Brest, Polotsk, Novopolotsk, Borissov, Maladechno, Pinsk, etc) même loin de la capitale et des (rares) lieux touristiques, les façades des bâtiments publics sont peintes, les gares chauffées en hiver, les jardins fleuris en été et les trottoirs nettoyés toute l’année. Les Russes le soulignent avec malice : « En voiture, tu sais que tu traverses la frontière entre notre pays et le Bélarus quand tu vois que soudainement les champs sont cultivés et entretenus ». Partout l’Etat est présent, et surtout sur le plan économique : 70% du PIB est généré par le secteur public, contrôle des prix sur les produits de première nécessité, redistribution des richesses, etc. Le développement du pays n’est pas juste une impression, il est reconnu par les organismes internationaux. Classé 53ème sur 189 pays selon l’indice de développement humain dans le rapport de 2018 de l’ONU, le Bélarus se trouve dans le groupe des Etats avec un « très haut développement ». Grâce à un système de santé performant, il enregistre un taux de mortalité infantile (nombre d’enfants morts avant l’âge d’un an sur 1000 naissances) très bas de 2,9. A titre de comparaison la Russie a un taux de 6,6 décès sur 1000 naissances, le Royaume Uni 3,7 et la Norvège 2,1. Le nombre de professionnels de la santé (médecins, spécialistes, etc.), pour 10.000 habitants, est de 40,7 au Bélarus (en Roumanie le chiffre est de 26,7 professionnels, 32 en Finlande, 41,9 en Suède). 99% de la population bélarussienne est alphabétisée et 91,9% des personnes de 25 ans ou plus ont bénéficié d’un enseignement secondaire (collège, lycée). En France, 83,2% a bénéficié de cet enseignement et 96,5% en Allemagne. Le Bélarus démontre donc, dans différents domaines, des résultats non négligeables comparables aux pays les mieux placés dans le classement des nations développées [1].

Pourtant le pays n’a pas bonne presse à l’Ouest et est régulièrement qualifié de « dernière dictature d’Europe » dans les médias. Cible de toutes les critiques : le charismatique et omniprésent président Alexandre Loukachenko, élu premier président de la république après l’indépendance de la nation (en 1991) et dont le cinquième mandat, actuellement en cours, se termine en 2020. Issu d’un milieu très modeste, né en 1954, cet ancien directeur de kolkhoze est porté au pouvoir par les électeurs du Bélarus en 1994 grâce à une campagne anti-corruption à l’encontre de la classe politique post-soviétique. Son arrivée à la présidence marque avant tout le signe du refus, de la part des Bélarussiens, de suivre la voie empruntée par les anciennes républiques de l’URSS après la chute du bloc communiste : la thérapie de choc ultralibérale. Témoins de la chute vertigineuse du niveau de vie des Russes et des Ukrainiens suite au démantèlement de l’Etat socialiste, les Bélarussiens se prononcent pour un changement de cap radical après une courte période intermédiaire (1991-1994) durant laquelle une politique nationaliste (prédominance de la langue bélarusse sur le russe) et libérale sur le plan économique était en train de s’opérer. Pour le nouveau gouvernement de Minsk, la privatisation des ressources nationales n’est plus à l’ordre du jour. Par référendum, le pouvoir de l’exécutif est renforcé et le drapeau de l’indépendance (blanc et rouge) remplacé par l’ancien drapeau de la république soviétique de Biélorussie (Rouge et vert, mais sans la faucille et le marteau). Viviane du Castel, docteure en sciences politiques et auteure de l’ouvrage « Biélorussie : une indépendance à la dérive » parle à l’époque d’un pays en cours de « re-soviétisation » [2].

A vouloir refuser le destin que lui prédestinaient tous les vainqueurs de la Guerre Froide, le Bélarus hérita donc d’un avenir différent de celui des vaincus. Le pays enregistra une croissance économique dès 1996 alors que la Russie ne l’entama qu’en 1997 et l’Ukraine en 2000. Au milieu des années 1990, l’espérance de vie s’était effondrée dans tous les pays de l’ex-URSS mais entamait une remontée au début du 21ème siècle, avec en tête le Bélarus (68,7 années d’espérance de vie en moyenne pour les deux sexes en 2003, la même année elle était de 65,6 années en Russie et 68,4 en Ukraine) [3]. Selon un rapport de 2004 de la Banque mondiale, le Belarus « a rapidement retrouvé une croissance de son PIB après le choc économique initial résultant de son indépendance, a réduit les niveaux de pauvreté de façon significative, a maintenu une ample couverture de services de santé et d’éducation et a accompli cela sans un accroissement des inégalités. Les mesures politiques mises en place ont réussi à maintenir le niveau de vie et à réduire la pauvreté mieux que dans plusieurs économies en transition » [4]. Sur le plan des inégalités, selon le Programme des Nations unies pour le développement, le coefficient de Gini (qui est un indicateur de la répartition des revenus, 0 étant l’égalité parfaite et 1 ou 100 étant l’inégalité la plus extrême) du Bélarus est l’un des plus bas du continent : 27 (Alors qu’il est de 37,2 en Estonie, 34 en Italie et 31,8 en Pologne… mais 25,6 en Islande). Aujourd’hui, bien qu’ayant éviter le rouleau compresseur néolibérale des années 1990, le pays reste un gâteau appétissant aux yeux des marchés privés et d’institutions internationales comme le FMI qui « en échange d’un prêt (…) exige des privatisations et la fin du contrôle des prix » [5]. Mesures auquel se refuse le gouvernement depuis l’arrivée au pouvoir de M. Loukachenko. Comme le souligna un jour celui-ci : « Il est plus facile d’enrichir 1000 oligarques que de créer une vie normale pour des millions de gens » [6]. Un tel bilan est d’autant plus remarquable que le « petit » Bélarus revient de loin. Principal théâtre de défoulement de la barbarie nazie durant l’invasion de l’URSS à partir de 1941, il a payé très cher le prix de l’occupation. La plupart de son territoire fut complètement détruit par les combats et la politique d’anéantissement de l’armée allemande. 20% de la population fut massacrée, des centaines de villages rasés. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le territoire bélarussien eût à supporter le plus lourdement les conséquences de l’explosion du réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl (Ukraine) en 1986 en absorbant 60% des retombées radioactives [7].
Laura est d’origine porto-ricaine et citoyenne des Etats-Unis. Elle déambule sur l’avenue de l’Indépendance, principale artère de la capitale, pour profiter de son après midi de libre. La jeune fille est venue pour apprendre la langue russe au sein des cours estivaux organisés par l’Université d’Etat linguistique de Minsk. « Je ne comprends pas » me confie-t-elle tout en désignant de la main les voitures et les passants, « j’ai un ami d’origine bélarussienne qui vit aux Etats-Unis. Quand je lui ai dit que je venais ici un mois il s’est exclamé que c’était une folie, qu’ici c’était une dictature et que tout était délabré ». Elle s’arrête un instant, observe les vitrines des boutiques et les façades des immeubles à l’architecture stalinienne, puis conclut : « Moi j’ai l’impression que les choses vont bien ici ». L’étonnement de Laura est compréhensible si l’on en croit l’image habituellement véhiculée par les médias hostiles au gouvernement. « Dictature en faillite » [8] ou « pays totalitaire » [9] sous la coupe d’un Loukachenko « glacial » [10], un « Staline biélorusse » [11], le pays a même eu l’honneur d’intégrer, en 2005, la très restreinte liste des « avant-postes de la Tyrannie » désignée par l’ancienne ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis, Condoleeza Rice. Accusation étonnante si l’on considère que la République du Bélarus, depuis son indépendance, n’a jamais envahi ni même bombardé aucune autre nation. Ce qui n’est pas le cas de son réprobateur. « Dites moi, chère représentante de la démocratie, pourquoi avez-vous détruit l’Irak ? » persifflait Alexandre Loukachenko en direction de la journaliste états-unienne Elizabeth Graham (Lally Weymouth), du Washington Post, en 2011. « C’est un crime international. Pourquoi n’êtes vous pas tenu responsable de ça ? De quelle démocratie peut-on parler après que des milliers d’Irakiens mais aussi des Américains aient été tués ? des gens qui avaient des enfants, des familles » [12]. A cheval entre les pays membres de l’OTAN et la Russie, la petite république se garde bien de trop pencher d’un côté ou de l’autre. « De par notre situation géographique, nous avons toujours été sur le chemin des campagnes militaires quand celles-ci venaient de France, d’Allemagne ou de Russie » rappelle Oleg Kravchenko, vice-ministre des Affaires étrangères [13]. « Trouver l’équilibre entre les deux côtés est une question de survie pour nous ». Une politique internationale qui amena le Bélarus à se proposer comme place neutre pour les pourparlers entre les différents acteurs du conflit ukrainien, en 2014, afin de favoriser la paix dans le pays voisin. « Ce que nous voulons c’est avoir des relations normales de coopérations, avec les Etats Unis comme avec tous nos voisins ».
{}

Dans le vieux centre-ville de Minsk, les bars branchés ne désemplissent pas le samedi soir. Toute la jeunesse urbaine vient se détendre, boire et flirter. Smartphone en main, Katya songe à son avenir « à l’Ouest ». Elle en rêve. « Regarde les faucilles et marteaux sur nos immeubles, c’est encore l’URSS ici ! » peste la jeune étudiante. Revenue d’un séjour en Lituanie, elle énumère les pays qu’elle a déjà visités. Russie, Ukraine, Bulgarie.. et ceux qu’elle souhaite voir : la France, l’Allemagne, la Grande Bretagne ! « Tu aimerais vivre dans ceux que tu as visités ? » « Ah non ! Je préfère le Bélarus ! La Russie c’est un désastre. Par contre je préférerais vivre en Europe de l’Ouest » répond Katya. « Mais es-tu déjà allée à l’Ouest ? » « Non, pas encore ». Beaucoup de jeunes citadins, ouverts aux discours des nations occidentales et à leur mode de vie (celui qui est retranscrit dans les fictions), nourrissent un rejet du système rattaché à l’image d’Alexandre Loukachenko dont la longévité au pouvoir est aisément un facteur d’irritation. Ils forment le public cible d’une opposition réelle, mais minoritaire dans le pays. Ales Bialiatski, activiste hostile au régime et ancien prisonnier (officiellement pour évasion fiscale), reconnaît lui même que cette dernière « n’est pas forte » [14]. Composée essentiellement de libéraux et de nationalistes bélarussiens, elle peine à dégager des figures politiques susceptibles de rivaliser avec le président Loukachenko. Beaucoup pourrait y voir là le résultat d’une politique de censure médiatique et de bâillonnement des discours alternatifs, hors les citoyens bélarussiens ont facilement accès à toutes sortes d’opinions et de médias privés. Comme M. Bialiatski lui-même le précise : « certains médias importants opèrent en biélorusse, mais depuis la Pologne. Il y a Radio Svoboda à Prague. Il y a un site Internet en biélorusse, basé à Varsovie. Cela crée une certaine alternative au monopole médiatique de l’État (…) Sur Internet, les sites démocratiques prennent plus de place que ceux de l’État » [15]. Rares sont les dictatures si tolérantes à l’égard de la presse d’opposition. Se sentant néanmoins investie d’une mission pour la défense du journalisme au Bélarus, Elizabeth Graham (encore !) mettait au défi le président bélarussien, lors de leur entretien, de « venir aux Etats-Unis » lui promettant d’être « surpris de voir que nous ne contrôlons pas ce que les journalistes écrivent dans leurs papiers ». Le retour de bâton ne se fit pas attendre et ce dernier lui rétorqua : « Vous faites ce genre de choses d’une façon différente. Vous contrôlez tout. Pourquoi avoir créer tout ce scandale avec Wikileaks et Assange ? Vous êtes des démocrates. Pourquoi voulez-vous emprisonner cette personne ? Il a publié des faits, et c’est pourquoi nous le connaissons. A-t-il écrit des mensonges ? Lesquels ? C’est la vérité et c’est ce que vous n’aimez pas. Vous avez entamé une campagne d’harcèlement contre cette personne pour l’extrader aux Etats-Unis et, comme je l’ai lu dans vos journaux, pour le condamner à mort » [16].
Malgré ces quelques vérités, c’est pourtant le Bélarus qui est constamment désigné comme le mauvais élève de la classe (européenne) et dont on souligne abondamment les atteintes aux droits fondamentaux. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU vota une nouvelle résolution à l’encontre du pays, en juin 2017, sur la base d’un rapport « encore une fois réalisé sans pouvoir visiter le pays ni rencontrer les autorités » mais appuyé « sur les renseignements donnés par les acteurs des droits de l’homme sur place, dont le Centre des droits de l’Homme Viasna, organisation membre de la FIDH » afin « d’envoyer un signal » au président Loukachenko [17]. Une résolution soutenue par différents Etats européens dont l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Portugal et le Royaume Uni.
Cas grave d’atteintes aux droits de l’homme, avec des répercussions en Europe, fut l’existence de prisons secrètes à l’initiative des services secrets états-uniens. Entre 2001 et 2005, l’Agence centrale de renseignements (CIA) organisa l’arrestation, le transfert et la détention illégale de citoyens (présumés terroristes) dans plusieurs centres de rétention clandestins basés dans différents pays. Cela faisait suite à la création, par l’administration du Président George W.Bush, de tribunaux d’exception en novembre 2001. Dans un article paru dans Le Monde diplomatique, l’auteur Giuletto Chiesa détaillait ces nouveaux organes de justice qui avaient la possibilité de juger sans « étayer de telles accusations de preuves » ni besoin « d’inculper ou d’informer l’accusé » ; « la présence d’un avocat n’est pas obligatoire » et « les procès peuvent être secrets ». Point culminant de cette barbarie moderne, « Les preuves et les aveux obtenus sous la torture, non valables dans les procès habituels, sont ici acceptés » [18]. Il est évident qu’une telle aventure illégale (et immorale) allécherait un régime sanguinaire et totalitaire comme le Bélarus. Selon un rapport de l’association humanitaire Open Society Justice Initiative, 54 gouvernements nationaux se sont rendus complices de ce programme brutal de la CIA, dont 22 sur le continent européen : l’Albanie, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la République Tchèque, le Royaume Uni, la Turquie et la Suède [19]. La République du Bélarus n’y participa pas.
Loïc Ramirez
Photos :
n°1 : Jeune écolière bélarussienne, dans le Sud du pays.
n°2 : Rentrée des classes, à Axova.
n°3 : Parc à Minsk.
n°4 : Bâtiments à Minsk.
n°5 : Hall de gare, ville de Gomel (Sud du pays)
[1] L’ensemble des données citées sont consultables sur le rapport 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement.
[2] La Biélorussie : une indépendance à la dérive, Viviane du Castel, l’Harmattan, 1999. Page 196.
[3] Reassessing Lukashenka, Belarus in cultural and geopolitical context, Grigory Ioffe, Palgrave Macmillan, 2014.
[4] Belarus : poerty assessment. Can Poverty Reduction and Access to services be sustained ? Main report, Wolrd Bank, November 2004.
[5] https://www.lemonde.fr/europe/article/2011/06/15/le-fmi-demande-a-la-bielorussie-de-liberaliser-son-economie_1536386_3214.html
[6] Reassessing Lukashenka, Belarus in cultural and geopolitical context, Grigory Ioffe, Palgrave Macmillan, 2014, page 197.
[7] La dernière république soviétique. La Biélorussie : une oasis sociale, économique et politique en Europe ?, Stewart Parker, éditions Delga, 2019.
[9] https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-dernier-pays-totalitaire-d-europe-51b88b43e4b0de6db9ac929c
[12] {} Interview avec le Washington Post, 2011, consultable à l’adresse : https://www.belarus.by/en/press-center/speeches-and-interviews/interview-of-president-of-the-republic-of-belarus-alexander-lukashenko-to-the-washington-post-usa_i_0000002095.html
[13] Voir l’entretien avec Oleg Kravchenko, par l’auteur, sur le site Le Courrier de Russie : https://www.lecourrierderussie.com/international/2018/10/oleg-kravchen...
[15] Ibid.
[16] Interview avec le Washington Post, 2011, consultable à l’adresse : https://www.belarus.by/en/press-center/speeches-and-interviews/interview-of-president-of-the-republic-of-belarus-alexander-lukashenko-to-the-washington-post-usa_i_0000002095.html
[17] https://www.fidh.org/fr/plaidoyer-international/nations-unies/conseil-des-droits-de-l-homme/le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu-pointe-encore-du-doigt-le
[18] {} « L’archipel des prisons secrètes de la CIA », Giuletto Chiesa, Le Monde diplomatique, août 2006.
[19] Rapport consultable sur le lien : https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture-20120205.pdf