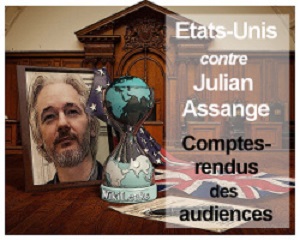Les problèmes culturels ne sont pas secondaires par rapport aux problèmes politiques ou économiques. Tout se tient et les langues, les moyens de communication de masse sont des armes ou des moyens de pression au même titre que le cours des matières premières ou les transnationales. C’est pourquoi l’affirmation d’une identité linguistique, le maintien des cultures locales sont, on l’a dit, « aussi peu négociables que le maintien d’une défense nationale ». Et cette identité linguistique ne saurait être duale : le sabir dans la technologie, la recherche, les affaires, les langues locales dans le reste. Face à la dissémination du sabir dans des secteurs de plus en plus nombreux, il y a urgence d’autant que, souvent, les intéressés acceptent l’aliénation et raillent les efforts de ceux, très minoritaires, qui tentent d’endiguer la marée atlantique. Ainsi, on a vu chez nous, il y a de cela presque trente ans, les initiatives de Jacques Lang en faveur de la chanson française, accueillies par les sarcasmes d’une bonne partie de la presse et des milieux professionnels eux-mêmes. C’est que la chanson anglo-américaine, en tant qu’industrie, payait davantage que la chanson française, belge ou ivoirienne. En réaction, et par dérision, Lang avait écrit en anglais, pour mieux se faire entendre, à la présidente de la Haute Autorité pour l’Audiovisuel afin de lui rappeler les obligations contenues dans le cahier des charges des sociétés nationales de radio-télévision. Dans le même ordre d’idées, en Septembre 1981, une circulaire du ministère de la recherche et de la technologie sur l’utilisation de la langue française dans les colloques scientifiques avait été accueillie avec hostilité par la presse spécialisée et par de nombreux chercheurs.
Si nombre d’Européens sont désormais des " transculturels " , des dualités monstrueuses mid-Atlantic avec un esprit américain dans une peau d’Européen, c’est parce que la puissance des empires se mesure toujours à l’aune de la faiblesse des colonisés. Cette faiblesse est économique et militaire, mais aussi culturelle. Un impérialisme se développe à la faveur d’un rapport de forces, puis grâce à la fascination, voire la complicité du colonisé, subjugué par un modèle extérieur qu’il pose lui comme supérieur. Alors la puissance économique apparaît comme un état de fait incontournable, légitimé par une excellence culturelle consensuelle.
L’impérialisme culturel draine un surplus de ressources matérielles puis il tend à atténuer la diversité des cultures au profit d’une homogénéisation qui gomme les idiosyncrasies et n’apporte rien aux communautés périphériques. En tout état de cause, rien de fondamental, mais au contraire des produits culturels prédigérés, standardisés, voire dégradés. Et l’on ne voit pas pourquoi le fameux "creuset " , le " melting pot " qui n’a pas opéré en profondeur outre-atlantique produirait quoi que ce soit de positif en s’universalisant. Il ne ferait au contraire que nier les différences.
Aujourd’hui, trois exemples d’aliénation fort différents les uns des autres :
- Outre le fait qu’ils nous informent qu’il va faire 12° « sur Toulouse » au lieu de « à Toulouse », les présentateurs de la météo nous disent régulièrement que « le vent soufflera à 80 kilomètres par heure (per hour) au lieu de « 180 kilomètres à l’heure » ou « 180 kilomètres-heure ».
- Un calque de plus en plus courant est l’utilisation du verbe dévaster dans le sens figuré qu’il peut avoir en anglais. On entend ainsi « j’ai été dévasté » (I was devastated) en lieu et place de terrassé, foudroyé. The news devastated him sera traduit par « la nouvelle l’a dévasté » au lieu de, par exemple, « cette nouvelle lui a porté un coup terrible ». « Cette », de préférence à « la » car l’article défini en anglais est souvent plus démonstratif qu’en français.
- Pour finir, quelques emprunts devenus ringards ; il s’agissait d’aliénation historique au sens où le français évacuait le substrat historique de ces vocables. A l’époque du yé-yé, on rencontrait souvent les mots kid ou teengager. Le sens premier de kid étant chevreau, ce mot est une métaphore en anglais, ce qu’il n’est pas en français. Comme teddy-boy, le mot teenager a une histoire : il vient de l’expression to be in one’s teens (avoir entre 13 et 19 ans), qui date du milieu du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, on parle, en français, d’enfant et d’ado.
Dans les films de Vadim des années soixante, on prenait un drink, mot qui a complètement disparu de notre circulation. Peut-être parce qu’il était d’un usage franchement bourgeois, ce qu’il n’est pas spécialement en anglais. Toujours dans les films de Vadim, une personne smart était élégante (l’anglais utilise smart ou elegant, mais smart n’a pas le sens moral que peut avoir le français élégant). Aujourd’hui, smart, en français (ou en allemand : la Mercedes Smart) signifie malin, dégourdi. On le rencontre, en particulier, dans le langage publicitaire. Cela dit, en anglais, cette acception a son pendant négatif : roublard, retors.