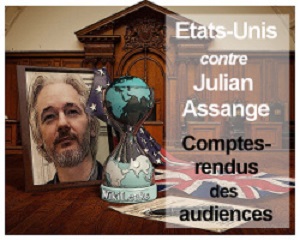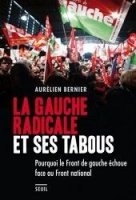Tomber, tomber la chemise… Le refrain de la fin des années 1990 connaît un soudain regain de succès syndical. Entonné sur le pavé parisien le 8 octobre avec une gouaille populaire et ironique bien française, il constitue évidemment un clin d’œil aux événements qui ont accompagné le Comité central d’entreprise d’Air France trois jours plus tôt. Les images des deux dirigeants de cette compagnie contraints de fuir, liquette en lambeaux, ont fait en un instant le tour de France, et du monde.
Des « violences intolérables » se sont étranglés de rage Manuel Valls, Nicolas Sarkozy et pas mal d’autres. En réalité, l’important n’est pas de disséquer ce qui s’est passé ce jour-là à Roissy, ou de peser la pertinence des réactions de certains des manifestants rassemblés. L’essentiel est ailleurs : pourquoi, tant de rage, de haine et de déchainement des puissants contre ces derniers ? Et pourquoi, à l’inverse, un tel écho populaire, qu’il soit proclamé ou discret, avoué ou inconscient ?
Une première explication est à trouver du côté d’un contraste : si la « violence » réelle a été somme toute modeste, la violence symbolique fut considérable. Mesure-t-on bien la force de cette image : des patrons contraints de fuir piteusement devant la colère de ceux qui sont habituellement soumis, contraints, humiliés ? Depuis quand une telle scène ne s’était-elle pas produite ? L’espace d’un instant, le rideau s’est fugacement écarté sur la vérité, sur la brutalité des rapports sociaux – mais, très exceptionnellement, dans le sens d’un retour de bâton.
Car la violence, ce n’est pas seulement la menace de licenciements. Pour des millions de salariés, du jeune ouvrier intérimaire à l’ingénieur expérimenté, le quotidien, c’est l’inquiétude du lendemain, le mépris subi, le travail non reconnu. Avec pour rengaine permanente : compétitivité, concurrence internationale, sacrifices inévitables... Pour n’évoquer qu’Air France, a-t-on pris la mesure des violences qui se sont déployées, un plan « Perform » succédant immédiatement à un plan « Transform » (10 000 suppressions de postes en trois ans) ? Quelle époque vivons-nous quand est banalisée l’exigence imposée aux pilotes : travailler l’équivalent de deux mois supplémentaires par an – gratuitement ? Quand le refus de ceux-ci les transforme en coupables du malheur des autres catégories de personnel, déjà précédemment sacrifiées ? Quand leur syndicat est... trainé en justice pour n’avoir pas tenu les engagements de « gains de productivité » ? Quand le PDG de la compagnie pourrait diviser par trois son salaire, et gagnerait encore, en net, plus que le chef de l’Etat, en brut ?
La seconde raison tient au moment : la colère des salariés a déferlé alors même que tant le gouvernement français que la Commission européenne, soutenus par plusieurs syndicats, mettent plus que jamais en avant la seule voie « raisonnable » : le dialogue social. Justement, le 2 octobre s’achevait le congrès de la Confédération européenne des syndicats (CES), inauguré par le président de l’exécutif européen et le chef de l’Etat français, congrès qui a eu le « dialogue social » comme fil rouge. Le 15 octobre, un « sommet social européen », rassemblant patronat, syndicats, et chefs politiques de l’UE se tenait – en toute discrétion. Et le 19, François Hollande mettait en scène la énième « conférence sociale ». Dans ce contexte, le « dialogue social » tourné en dérision à la façon « tomber la chemise » avait de quoi en rendre fou de rage quelques uns...
Enfin, certains responsables politiques ont stigmatisé la « dégradation de l’image de la France » dont seraient responsables les salariés en colère. Avec ce sous-texte : que vont penser les investisseurs ? Les investisseurs, c’est-à-dire ceux dont on apprend quasi-quotidiennement qu’ils rachètent ici une usine (quitte à la fermer ensuite), là un aéroport, là-bas un savoir-faire.
L’image de la France ? Pour des millions d’hommes et de femmes dans le monde, ce n’est pas celle du président Hollande appliquant les consignes de Bruxelles, ou multipliant les courbettes devant le monarque saoudien dans l’espoir de contrats juteux. Ce serait plutôt celle de Jeanne d’Arc, de Robespierre ou du colonel Fabien – celle du refus de la soumission, de la servitude, de l’injustice, de l’humiliation.
Entre le « dialogue » et la violence, ceux-là avaient choisi. Un choix anachronique ? Peut-être pas tant que cela. Et c’est cela qui enrage les puissants d’aujourd’hui.
Et surtout, les inquiète.
Éditorial paru dans l’édition du 27/10/15 du mensuel Ruptures
Information et abonnements : http://www.ruptures-presse.fr
Pierre Lévy est par ailleurs l’auteur d’un roman politique d’anticipation dont une deuxième édition est parue avec une préface de Jacques Sapir : L’Insurrection