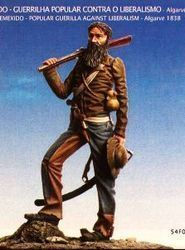
La lutte contre le néolibéralisme a déjà toute une Histoire derrière elle. Elle est passée par plusieurs étapes (de la résistance, à l’élaboration d’alternatives) et doit aujourd’hui affronter la violente contre-attaque de la droite. L’année où fut inauguré le Traité de Libre Echange d’Amérique du Nord (ALENA ndt) -1994-, les zapatistes avaient appelé à la résistance contre cette nouvelle vague hégémonique. Ignacio Ramonet lançait quant à lui, dans un editorial du Le Monde Diplomatique -1997-, un appel à la lutte contre la « pensée unique » et contre le consensus de Washington. Le Forum Mondial -2001- appelait pour sa part à la construction d’un « possible nouveau monde ». Quant aux manifestations contre l’Organisation Mondiale du Commece (OMC), qui avait commencé à Seattle en 2001, elles révélaient autant l’ampleur du malaise provoqué par ce nouveau modèle hégémonique qu’elles constituaient une véritable démonstration de force des mobilisations populaires. Il s’agissait-là d’une première étape : celle de la résistance, défensive, face aux faramineuses régressions qui s’opéraient du fait du passage d’un monde bipolaire à un autre monde, unipolaire (sous le contrôle hégémonique de l’impérialisme états-unien), d’un modèle de régulation à un un autre modèle, néolibéral.
Sur le plan gouvernemental, la consolidation de l’hégémonie néolibérale fut marqué par le passage de la génération droitière qui en avait posé les fondements (Pinochet, Reagan, Thatcher) à une seconde génération que d’aucuns dénommèrent « la troisième voie » (Clinton, Blair, Cardoso), ce qui leur permettait d’occuper tout l’espace politique. Cette force compacte rencontra un premier revers avec l’élection d’ Hugo Chávez à la tête du Vénézuéla - 1998 -, et, à partir de ce moment, ne cessa plus d’en rencontrer en Amérique Latine où les principaux promoteurs du nouveau modèle (Cardoso, Menem, Fujimori, Carlos Andrés Pérez, el PRI) furent mis en échec.
Cette réaction populaire s’illustra par les triomphes électoraux qui suivirent celui de Chávez - Lula (2002), Kirchner (2003), Tabaré Vázquez (2004), auxquels ont peut ajouter le triomphe de Daniel Ortega (2006) -, et présenta au monde une arène politque tout à fait différente de celle qui était attendue. Bien que l’ayant emporté face à des gouvernement connus pour leur orthodoxie néolibérale, ces nouveaux élus ne misèrent pas sur une rupture totale avec le modèle néolibéral qu’ils ont conservé en l’assouplissant quelque peu, principalement en mettant plus fortement l’accent sur les politiques sociales.
Ce nuances apportées au néolibéralisme, ainsi que le choix de nouvelles options dans les processus d’intégration régionale (en premier lieu le MERCOSUR), ou encore la mise en échec du projet d’Alliance de Libre Echange des Amériques (auquel les nouveaux gouvernements ont activement participé), révèlèrent cependant des différences significatives quant à la relation que ces gouvernements entretenaient avec l’héritage des régimes qui les ont précédés, contribuant ainsi à l’émergence d’une arène politique inédite sur ce continent, dans laquelle se multiplièrent simultanément des formes de gouvernements qui avaient toutes en commun de s’opposer aux Traités et aux diverses formules de Libre Echange proposés par les Etats-Unis, ainsi qu’à leur politique de « guerre infinie » (laquelle n’obtint d’adhésion explicite qu’en Colombie).
Les victoires d’ Evo Morales (2005) et de Rafael Correa (2006), et le lancement de l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA), de la Banque du Sud (« Banco del Sur »), du gasoduc continental, et l’adhésion du Vénézuéla et de la Bolivie au Mercosur, donnèrent plus d’ampleur et de force à l’axe politique formé par les gouvernements qui, en plus de privilégier les processus d’intégration régionale, décidèrent de construire des modèles politiques et économiques en rupture avec le néolibéralisme. En ce sens, le triomphe du paraguayen Fernando Lugo (200 élargit encore un peu plus le camp des régimes progressistes sur le continent, auquel nous pourrons bientôt ajouter le Salvador.
Cependant, à partir de 2007, et après la relative surprise que fut la prolifération de gouvernements progressistes dans la région, la droite retrouva sa capacité d’initiative qu’elle avait perdu quand les forces populaires étaient parvenues à capitaliser, sur le plan électoral, le mécontentement généré par les défaillances des politiques sociales néolibérales, lesquelles constituent le maillon faible du néolibéralisme.
Afin de retrouver sa capacité d’initiative, la droite (qui traîne derrière elle la vieille droite oligarchique et l’ensemble des courant social-démocrates acquis au néolibéralisme) se retourna vers les sphères dans lesquelles son hégémonie n’avait pas souffert ou dans lesquelles elle conservait pour le moins l’essentiel de sa force : le pouvoir économique et le pouvoir médiatique. Cette contre - attaque pris des allures différentes selon les pays bien qu’on lui retrouve des points communs : critiques de la présence étatique dans les affaires économiques et des régulations introduites par l’Etat dans les processus d’intégrations régionales et mondiales ; thème récurrent de la « corruption » (toujours focalisé sur les gouvernement et l’Etat), les fuites de capitaux, l’autonomie des gouvernements régionaux prônée contre l’Etat centralisé, les soi-disant « menaces » à l’encontre de la « liberté de la presse » (qu’ils identifient à la presse privée) etc.
Une fois passé le choc créé par la prolifération des gouvernements échappant à son contrôle direct, la droite repris donc l’initiative. Au Brésil d’abord, avec les campagnes de dénonciations du gouvernement de Lula ; au Vénézuéla (après la tentative de coup d’Etat de 2002) , avec la défense des monopoles privés dans les médias et en dénonçant des formes de corruption et des fuites de capitaux ; en Bolivie, avec l’opposition à la réforme agraire, à la nouvelle Constitution et à l’application de nouveaux impôts aux exportations de gaz, impôts grâce auxquels le gouvernement central souhaite mettre en oeuvre diverses mesures sociales ; en Argentine, avec l’oopsition aux mesures de régulation et la dénonciation de fuites de capitaux ; en Equateur, avec les offensives contre la nouvelle Constitution et les nouvelles formes de normativité étatique.
Elle est aussi à la tête de deux pays importants dans la région (le Mexique et la Colombie), qui, pour le premier, cherche à mettre en marche un processus de privatisation de l’emtreprise pétrolière étatique Pemex, et qui, pour le second, renforce l’épicentre de guerres régionales sans fin.
Après la paralysie des années d’expansion de l’économie internationale, qui favorisait l’obtention de ressources venues du commerce extérieur pour renforcer les politiques sociales, la droite reprend encore l’offensive en dénonçant les risques d’inflation, en affirmant la nécessité de nouveaux ajustements, d’élever encore un peu plus les taux d’intérêts banquaires, de façon à redonner la priorité à la stabilité monétaire sur l’expansion économique.
L’étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement est marquée par la recrudescence des affrontements politiques et idéologiques entre gouvernements progressistes et opposition de droite. Les volontés de delester l’Etat de tout rôle central sont aujourd’hui au centre des débats et des polémiques qui opposent la droite et la gauche. Sur le continent, on voit désormais certains pays suivre le schéma de l’Etat minimum comme dans le cas du Mexique, qui tente de mettre en place la privatisation de PEMEX (exemple s’il en est du nouveau printemps privatisant du néolibéralisme continental), comme dans le cas du Pérou qui a adopté il ya peu (de même que le Costa Rica et le Chili) un modèle d’assurances privé.
A l’inverse, d’autres pays cherchent à refonder leurs systèmes étatiques en se basant sur des schémas post-néolibéraux et post-libéraux, et oeuvrent à l’élaboration de nouvelles formes de représentation politiques qui aillent plus loin que le veut le formalisme libéral, c’est le cas, par exemple, de la Bolivie et de l’Equateur (tous deux cherchent à instaurer des formes de société plurinationales, pluriethniques, pluriculturelles) ainsi que du Vénézuéla. De même, si certains pays se contentent de mettre en pratiques diverses formes de régulation étatique sans pour autant rompre avec les Etat néolibéraux préexistants, ils n’en freinent pas moins le démantèlement des services publics et, en renforçant les capacités sectorielles de régulation, n’en freinent pas moins non plus les processus de privatisation mis en place auparavant, renforçant par là même l’accroissement du travail contractuel et l’amélioration des services fédéraux (le Brésil et l’Argentine en sont l’illustration).
Le destin du modèle néolibéral dans le subcontinente n’est pas clairement arrêté. Son hégémonie continue, que ce soit parce que certains pays continuent de l’appliquer orthodoxalement, parce qu’il reste prépondérant, d’une façon ou d’une autre, dans la plupart des nations (Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, Chili, Pérou, Uruguay, Costa Rica) dans un monde dominé par le néolibéralisme. Son destin se décidera surtout dans les trois pays les plus forts économiquement. Parmi eux, le Mexique consolide toujours un peu plus l’hégémonie néolibérale, alors que l’Argentine et le Brésil préservent le modèle en tentant de l’accomoder malgré les menaces de forces d’oppositions de droites très présentes.
L’espace qui symbolise le mieux le processus de construction post-néolibéral est l’ALBA puisque ses membres (le Vénézuéla, Cuba, la Bolivie, le Nicaragua, auxquels viennent s’ajouter d’important échanges avec l’Equateur) y construisent des relations de solidarité et cherchent à répondre aux besoins et aux possibilités de chaque nation par des alternatives aux lois de « libre échange » de l’OMC, en pratiquant ce que le Forum Social Mondial appelle « commerce juste ». Cet espace est un espace typiquement post-néolibéral dont le futur dépend entièrement de la consolidations des processus politiques en cours dans ces pays.
Emir Sader
La Jornada
Traduit de l’espagnol par Céline Meneses


